Qui hante vraiment l’Amérique ? Déconstruire le trope du cimetière indien
Les Amérindiens sont des victimes fondatrices du cinéma depuis l’aube de la filmographie américaine, lorsque les westerns ont construit leurs marques sur des affrontements dramatiques entre des cow-boys héroïques maniant les armes et des « sauvages » autochtones.
Tout comme le mythe de la frontière a été fondamental pour l’établissement de la croissance et de l’éventuelle hégémonie (toujours plus catastrophique) de l’Amérique, l’exploitation violente et le meurtre de personnes vivant simplement dans leurs terres natales ont longtemps été l’or d’Hollywood.
En peignant les Amérindiens comme des entités surnaturelles et monolithiques qui tourmentent d’innocentes familles blanches, de nombreux films d’horreur classiques jouent sur les illusions blanches de propriété, de droit et de victimisation. Ils recentrent également l’idée que la blancheur comme une « norme » qui est perturbée ou hantée par l’altérité.
Cette « altérité » peut être et a été queer (shout to the Babadook), féminine (Salem, anyone ?), migratoire, neurodivergente, noire, pauvre, malade mentale, ou vraiment une partie de toute catégorie qui menace l’idéal blanc nucléaire (faute d’un meilleur terme). Comme le trope des bois sombres et effrayants, l' »autre » est une forêt profonde qui – selon l’imagination coloniale – doit être pavée – mais peut-être est-il temps de regarder réellement ce qu’il y a en dessous.

Gay BabadookBBC
It Came from Amityville : La naissance du trope cinématographique du cimetière indien hanté
Peu de tropes cinématographiques incarnent mieux la cooptation et la vilification continue des Amérindiens par l’industrie cinématographique blanche que le mythe du « cimetière indien hanté »
Bien que l’idée des hantises amérindiennes soit assez ancienne, le film le plus célèbre qui utilise le trope du cimetière indien hanté est peut-être L’horreur d’Amityville. Le roman emblématique de Jay Anson, paru en 1977, et la franchise d’horreur qui en a découlé, se concentrent sur une maison de Long Island, dans l’État de New York. Présentant le récit comme une histoire vraie, Jay Anson raconte l’histoire d’un couple qui a acheté une maison qui a été le théâtre de six meurtres. Le couple a ensuite été confronté à une série de hantises étranges.
Selon le roman d’Anson, le couple a fini par consulter un membre de la société historique d’Amityville et a découvert que la maison avait été construite sur le site d’un foyer d’Indiens Shinnecock pour les « malades, fous et mourants. » L’historien leur a également dit que les Indiens croyaient que la maison était infestée de démons. Une étude ultérieure menée par des enquêteurs paranormaux a conclu que la maison était hantée par un chef indien Shinnecock et qu’elle avait été construite sur – quoi d’autre – le site d’un cimetière amérindien.

Amityville HorrorUFOInsight
Ceci, en fait, était totalement inventé. Les Indiens Shinnecock vivaient à des kilomètres du site d’Amityville, et les Amérindiens ne gardaient pas leurs malades et leurs mourants dans des maisons de fous séparées (contrairement aux colons, qui semblent généralement aimer absolument enfermer leurs malades mentaux et explorer ensuite les ruines abandonnées de ces anciennes prisons).
Après Amityville, la spore du mythe du cimetière indien a commencé à se répandre. Étrangement, l’un des cas les plus célèbres de ce trope ne s’est jamais réellement produit. Beaucoup de gens croient que le Poltergeist de 1982 implique une maison construite sur un cimetière indien, mais c’est un exemple de l’effet Mandela (ou peut-être la preuve que le film est réellement hanté) : Le film indique spécifiquement que sa maison centrale hantée n’a pas été construite sur des terres tribales.
Dans les années 80 et 90, le trope est devenu encore plus populaire. Le roman Pet Sematery de Stephen King est centré sur un cimetière amérindien qui a le pouvoir de ramener les morts à la vie. King a écrit le roman à une époque où les tribus Maliseet, Penobscot et Passamaquoddy poursuivaient l’État du Maine, arguant que la loi fédérale leur donnait 60 % de l’État. Le gouvernement a versé 81 millions de dollars aux tribus en échange de l’abandon des parties développées du Maine. Le roman de King aborde cette histoire mais ne l’interroge jamais de manière significative.
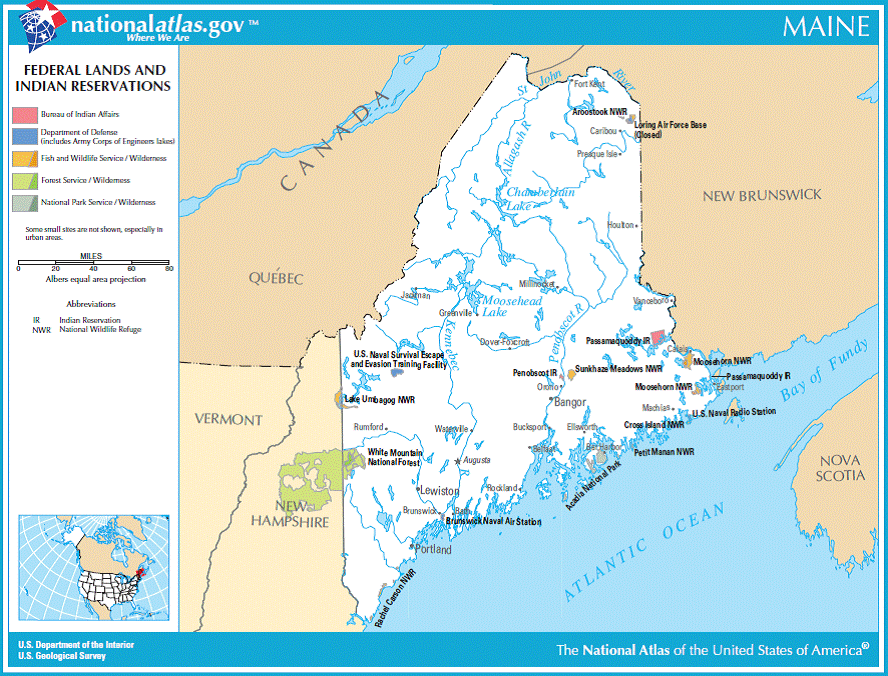
ssa.gov
Le mythe du cimetière indien apparaît dans The Shining. La maison de Buffy Summers dans Buffy the Vampire Slayer a été construite sur un cimetière indien, et d’innombrables autres films d’horreur classiques ont utilisé ou parodié ce trope.
On pourrait penser que le trope du cimetière indien se serait épuisé depuis le temps, et pourtant il revient encore de temps en temps. La plupart des films qui centrent fortement ce thème sont des films de série B comme Silent Hill : Revelation, mais The Darkness de 2016 voit Kevin Bacon affronter des fantômes après avoir ramené d’anciens artefacts Anasazi.
Qui hante vraiment l’Amérique ?
La plupart des tropes nous disent quelque chose sur le contexte culturel plus large dans lequel ils trouvent leur origine, et le mythe du cimetière indien n’est pas différent. « Le récit du cimetière indien hanté cache une certaine anxiété concernant la terre sur laquelle vivent les Américains – en particulier les Américains blancs de la classe moyenne », écrit Colin Dickey pour The New Republic. « L’idée de la propriété – le Saint Graal de la vie de la classe moyenne américaine – est profondément ancrée dans l’idée que nous ne sommes pas, en fait, propriétaires de la terre que nous venons d’acheter. À maintes reprises dans ces histoires, des familles américaines parfaitement moyennes et innocentes sont confrontées à des fantômes qui ont persévéré pendant des siècles, qui restent vengeurs des dommages causés. Affronter ces fantômes et les expulser, dans nombre de ces histoires d’horreur, devient un moyen de se battre à nouveau contre les guerres indiennes des siècles passés. »
Dickey est l’auteur de Ghostland, un livre qui explore la signification culturelle de l’obsession de l’Amérique pour les lieux hantés – manoirs, motels, enseignes délabrées et vieilles houes de banlieue. Les fantômes, conclut-il, sont « une métaphore commode pour toute une série de problèmes qui ne sont pas liés au surnaturel » et en parler « devient un moyen de traiter ou de donner un sens à des expériences qui peuvent autrement sembler écrasantes ou mystifiantes ». En bref, les histoires de fantômes aident les gens à comprendre les questions non résolues et troublantes.

Brooke M JanoWordpress.com
Dans de nombreux films modernes, les protagonistes blancs sont présentés comme des héros qui assassinent brutalement des monstres dont ils savent peu de choses afin qu’eux et leurs familles puissent retourner à leur mode de vie tranquille en banlieue. On peut soutenir que ce sentiment n’est pas très éloigné de l’éthique xénophobe qui sous-tend Make America Great Again. (Dans son article « Haunted America : Le fantôme de George Floyd et le fantôme de la Confédération, Chauncey Devaga soutient que « ‘Make America Great Again !’ est une incantation qui canalise les pires parties du passé et du présent de l’Amérique pour blesser les Noirs et les Bruns. »)
De la malédiction du pharaon et de la malédiction g*psy au vaudou hollywoodien et au trope du cimetière africain, la peur de l' »Autre » est un trope bien exploré (et bien exploité) dans le genre de l’horreur.
En fin de compte (bien que la mythologie américaine puisse dire le contraire), même la version la plus déformée de l’histoire devrait vous dire que si quelqu’un hante l’Amérique, c’est très probablement les colonisateurs européens, qui, dans leurs itérations modernes, pourraient bien être les gentils parents blancs de banlieue en bas de la rue et les fantômes racistes qui vivent en eux.
Peut-être que l’idéal de la famille nucléaire était le véritable « autre » depuis le début, un rêve spectral aux vêtements tachés de sang qui – à en juger par la prévalence des mouvements suprématistes blancs en Amérique – refuse de se rendre sans combattre.
Et si la véritable hantise était toujours le puits sans fond à l’intérieur du cœur des héros blancs de banlieue les plus aimés de notre culture ? Et si les horreurs déterminantes de la banlieue n’étaient pas les cimetières amérindiens qui se trouvent sous ses pelouses entretenues, mais quelque maladie que ce soit à l’origine de l’oppression coloniale ?
Et là encore, il y a des problèmes à inverser les tropes et à peindre la blancheur comme le monstre, ce qui ne fait peut-être que recentrer la blancheur en fin de compte. En vérité, les divisions binaires méritent aussi d’être critiquées, et le but ultime de ce genre d’analyse devrait probablement être de dissoudre entièrement l' »autre » en tant que catégorie – mais cela reste impossible tant que la justice ne devient pas réelle (et c’est une discussion pour une autre fois).
Changer le récit : Reclaiming Ghosts in the Present Day
« Il y a une différence significative entre les projections culpabilisantes et les obsessions sur les Indiens morts qui gangrènent l’imaginaire colonial et les types de manifestations que les peuples indigènes rencontrent lorsque leurs lieux de sépulture sont perturbés », écrit Colleen Boyd dans « ‘You See Your Culture Coming Out of the Ground Like a Power’ : Uncanny Narratives in Time and Space on the Northwest Coast. »
Pour commencer à guérir, il doit y avoir un recentrage et un changement de qui raconte l’histoire. Cela peut se produire au sein des histoires d’horreur, et les hantises peuvent même être des espaces de décolonisation et de révolution.
« Être hanté par les morts ancestraux est une autre voie pour revendiquer des droits à (ré)occuper et (re)définir des terres appropriées par des processus coloniaux », poursuit Boyd. Certains de ces récits brisent le binaire entre soi/autre et vie/mort, en considérant les fantômes comme des mécanismes de connexion à un lieu. Les hantises peuvent être des actes d’amour ou des façons alternatives de cartographier l’espace et le temps. « Être possédé intérieurement par des esprits, en ce sens que les éprouver crée un sentiment d’appartenance à ceux-ci, délimite également une frontière extérieure pour la possession géographique et culturelle », poursuit-elle.
Les hantises et l’horreur peuvent également être des moyens de contextualiser les traumatismes actuels et la guérison, en dépeignant les lignes de temps fracturées des traumatismes psychologiques d’une manière que le réalisme linéaire ne peut pas.
« En tant qu’indigènes, nous comprenons cette violence, nous comprenons le génocide et le traumatisme, nous savons que notre femme n’est pas en sécurité dans ce pays, que nos sœurs, nos mères, nos tantes et nos filles sont assassinées et violées aux mains des hommes blancs », écrit Ariel Smith an dans un article de Off Screen intitulé « Cet essai n’a pas été construit sur un cimetière indien ». « Nous comprenons l’horreur, nous la vivons tous les jours ».
Histoires divergentes : L’importance des films d’horreur amérindiens
Alors, quelle est la solution ? La réponse ne peut pas simplement être un changement vers l’exploitation des traumatismes ou la capitalisation soudaine des histoires pour remplir les quotas de diversité. La culture et l’histoire amérindiennes sont pleines d’une sagesse riche et profonde. Elle est également truffée d’un grand nombre de monstres extrêmement terrifiants.
Pour autant, c’est peut-être mieux qu’Hollywood ait été extrêmement lent à adopter toute sorte d’histoires amérindiennes, du moins tant que des cinéastes blancs sont encore aux commandes.
« Les histoires de monstres peuvent avoir des associations très différentes dans les histoires amérindiennes », explique Tiffany Midge, membre des Sioux de Standing Rock et poète de Moscou, dans l’Idaho. « Dans certaines traditions, les différents monstres sont des divinités. Mais il y a certainement beaucoup d’éléments dits « d’horreur » dans un grand nombre de légendes autochtones. Mais leur imposer des interprétations occidentales les aplatit et les diminue dans une certaine mesure. »
La solution consiste probablement à simplement passer le micro et à laisser les cinéastes amérindiens (ainsi que les cinéastes non blancs en général) parler pour une fois.
Smith met en lumière le cinéaste Jeff Barnaby, qui crée « des films encadrent un espace où les non-indigènes doivent regarder l’écran et se sentir repoussés, effrayés et peu sûrs d’affronter la vérité et la réalité terrifiante et grotesquement violente qu’est la construction d’une nation, de style colonial », poursuit Ariel Smith.

Arrêt sur image de Blood Quantumbloody-disgusting.com de Jeff Barnaby
Les films de Barnaby et d’autres histoires réalisées par des autochtones créent des voies de narration indépendantes et autonomes. « Les cinéastes indigènes qui travaillent à l’intérieur et à l’extérieur du genre de l’horreur affirment une souveraineté visuelle en résistance aux récits maîtres coloniaux », écrit Smith, « et ce faisant, ils illustrent le fait que l’auto-expression indigène est intrinsèquement liée à l’autodétermination indigène. »
Alors, peut-être qu’avant de jeter The Shining pour la dix millième fois et de passer deux heures et demie à regarder des Blancs hurler à tue-tête (parfois littéralement) dans de gigantesques maisons de banlieue, vous pourriez essayer des films d’horreur réalisés par des indigènes comme Blood Quantum de Barnaby, Older Than America de Georgina Lightning, Imprint de Michael Linn, ou l’un de ces neuf films d’horreur réalisés par des indigènes.
Et avant de commencer à attribuer ces cahots dans la nuit à une quelconque malédiction mystique, vérifiez peut-être dans votre propre esprit les signes d’angoisses plus profondément enracinées concernant la terre sur laquelle votre maison a été construite.